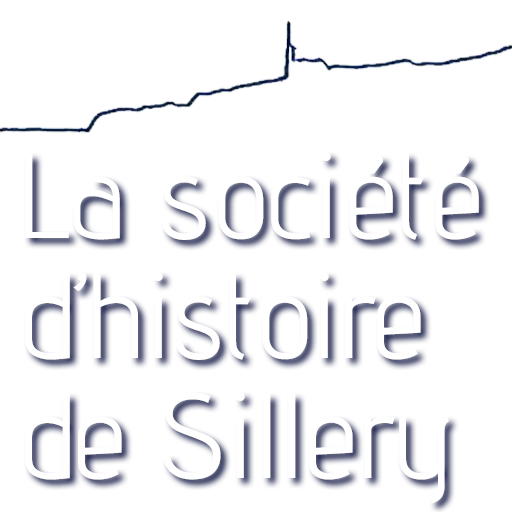Les anciennes villas de Sillery : la villa Woodfield 🏠🌳
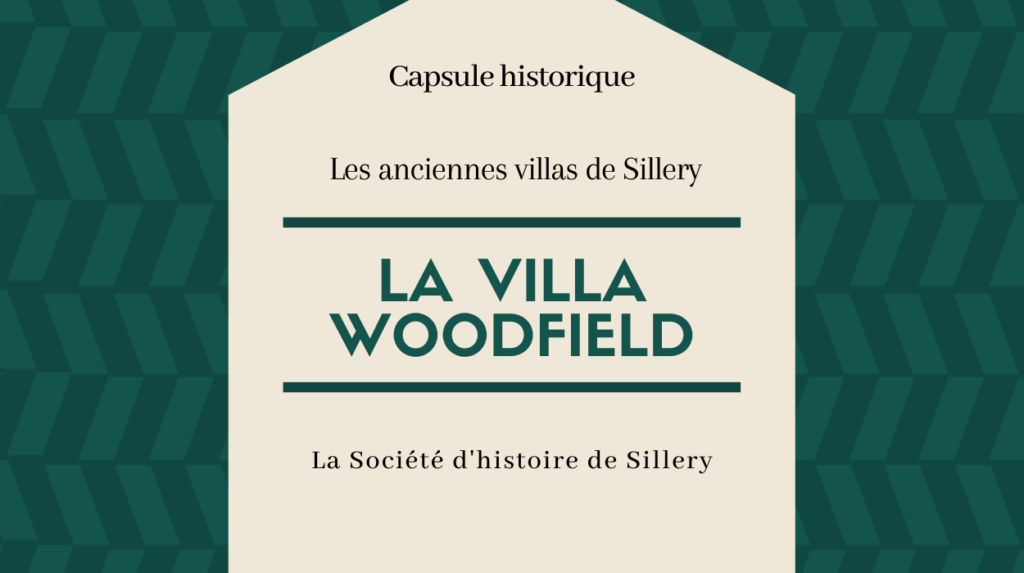
Votre capsule historique hebdomadaire : la villa Woodfield !
Nous commençons avec cette capsule une nouvelle série sur l’histoire de Sillery : celle sur les anciennes villas. La tradition est de débuter l’implantation des villas à la suite de la mort du dernier jésuite au Canada. C’est en le 16 mars 1800, alors que le père Jean-Joseph Casault meurt que le Gouvernement du Bas-Canada peut disposer des biens des jésuites, dont la seigneurie de Sillery. Les marchands de bois qui louent les anses de Sillery à la suite du blocus continental de Napoléon (1806-1814) achètent les terrains au haut de la falaise de Sillery et s’y font construire des maisons de campagne qui deviendront des villas au centre du domaine. Pourtant, cette façon de faire était beaucoup plus vieille. Déjà, au milieu du XVIIe siècle, le gouverneur Louis d’Ailleboust s’installe un manoir à la Châtellenie de Coulonge. Il y habite, même après la fin de son mandat comme gouverneur. Tout à côté (à l’ouest de la châtellenie et à l’est du fief Saint-Michel) la même chose se produit, mais cette fois avec un ecclésiastique.

Mgr Dosquet (archives du diocèse de Québec)
Cette terre de 50 arpents a connu de nombreux propriétaires entre sa première concession en 1649 et sa transformation en villa. Au milieu du XVIIe siècle, il existe bien une maison sur cette terre puisque deux des enfants du propriétaire Barthélémy Gaudin sont baptisés à la mission Saint-Joseph. Mais ce n’est, en réalité, qu’une bonne maison paysanne. Les choses vont changer en 1728. Cette année-là, un sulpicien belge, Pierre-Herman Dosquet est nommé coadjuteur (évêque auxiliaire) de Québec. N’ayant pas de siège épiscopal, on lui donne un titre honorifique, donc un évêché qui n’existe plus pour l’Église catholique. Il est donc titré évêque de Samos, une petite île grecque de la mer Égée alors (et toujours jusqu’à maintenant) dans les limites de l’Église orthodoxe. Monseigneur Dosquet devrait habiter au palais épiscopal de Québec, d’autant plus que l’évêque en titre, Mgr Louis-François Duplessis de Mornay ne vient pas en Nouvelle-France. Mais le palais épiscopal est presque laissé l’abandon et les titres de propriété ne sont pas certains. Malgré cela, après de nombreuses et couteuses réparations, il peut l’habiter. Mais il n’est pas à l’aise avec la présence importante de la population sur son chemin de ronde.
Il est donc normal qu’en 1730, Mgr de Samos cherche à trouver une nouvelle demeure. Il va acheter, sur les hauteurs de Sillery une terre, qui prendra le nom de Samos. Il y fait construire une villa. En 1732, il repasse en France afin de demander que l’évêque en titre de Québec soit obligé de venir s’établir en Nouvelle-France ou de démissionner. Et c’est ce qui va arriver : Mgr Duplessis de Mornay devra démissionner et Mgr de Samos devient Mgr de Québec. Il va donc « déménager » le palais épiscopal sur sa terre de Samos et y installer sa suite. Éloigné des lieux de pouvoir (le gouverneur habite le château Saint-Louis et l’intendant son palais en basse-ville), mais aussi de la population qui ne le voit pas, il va prendre une suite de décisions qui ne satisferont ni la population, ni les autorités civiles et militaires, ni le clergé de la Nouvelle-France. Le 17 octobre 1735, il quitte avec sa suite la Nouvelle-France qui se retrouve, à nouveau avec un évêque absent. Deux ans plus tard, il démissionne. Pour non-paiement du prix d’achat et des rentes qu’il devait aux prêtres du Séminaire de Québec, la villa retourne dans les possessions du Séminaire. Elle sert au repos des prêtres du séminaire.

Les anciennes écuries de Woodfield (Cimetière St-Patrick)
Lors de la Conquête, la villa Samos est fortement endommagée par les bombardements britanniques. Le Séminaire de Québec vend alors la villa et la terre de Samos à un ami du gouverneur Murray. La villa est restaurée et agrandie, puis dénommée Woodfield. Après avoir de nouveau changé de propriétaire, la villa sert d’hôpital militaire aux troupes de Benedict Arnold lors de l’invasion de la Province of Quebec par les troupes américaines. Peu endommagée, elle retrouve ensuite son propriétaire qui loue sa maison comme lieu de repos et de villégiature. Pendant toutes ces années, la Province of Québec n’a toujours pas de diocèse anglican et dépend de celui Nouvelle-Écosse. Sous la pression du gouverneur Guy Carleton, lord Dorchester, un nouveau diocèse est créé pour le Haut et le Bas-Canada. Contre toute attente, le siège de ce nouveau diocèse est installé à Québec et c’est Jacob Mountain qui en est nommé premier évêque en 1793. Arrivé avec sa famille (sa femme, ses quatre enfants encore mineurs et la famille de son fils aîné, ses deux sœurs célibataires), il s’installe à Québec, mais deux ans plus tard, il décide de louer la villa Woodfield et d’y emménager avec sa famille. Ainsi, pendant 7 ans, le nouvel évêque anglican de Québec va habiter Samos. En devenant évêque anglican, Lord Mountain devient aussi membre des Conseils législatif et exécutif du Haut-Canada et du Bas-Canada. Ironie du sort, l’évêque Mountain utilisera ces fonctions politiques pour devenir l’un des plus importants opposants à l’Église catholique canadienne. Il profite de sa position pour bloquer la création de nouvelles paroisses, pour refuser le refuge aux Français qui fuient la Révolution française et pour pousser le gouvernement à confisquer les biens des sulpiciens, la dernière communauté religieuse masculine à recruter au Bas-Canada. Après le départ de Mgr Mountain, la villa est vendue à Mathew Bell (directeur des forges du Saint-Maurice), puis à William Sheppard qui transforme complètement la villa pour en faire un exemple des grandes villas de Sillery. Il ne reste maintenant de cette époque que les anciennes écuries et le tracé du jardin.
Si Mgr Dosquet a laissé son nom à une rue dans le secteur des Gouverneurs, son nom a aussi été utilisé pour une résidence sur l’avenue du Maire-Beaulieu. Pour ce qui est du nom de Mountain, il est associé à l’école anglophone (maintenant bureau administratif) du chemin Saint-Louis, près de l’avenue Maguire. En fait, le nom de l’école fait référence à George Jehoshaphat Mountain, son fils, troisième Lord-Évêque de Québec. Indirectement, il est aussi associé à l’église anglicane St Michael puisque le petit-fils du Lord-Évêque de Québec, Armine Wale Mountain en fut le premier pasteur.
Pour lire toutes nos capsules historiques, cliquez ici.