𝐋’𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐜𝐨̂𝐧𝐞, 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞
L’art de l’icône, un lien entre le divin et le monde terrestre
Pour notre avant-dernière capsule avant les vacances, nous avons pensé vous faire découvrir un art peu courant chez nous, mais qui fait partie de la vie courante de millions de personnes. Nous profitons de l’exposition Parolicône à l’église de Saint-Michel à Sillery pour vous faire connaître un art majeur peu connu, celui de l’icône.
Les origines des icônes
Même si l’art de l’icône est présent dans la culture catholique et chez certains protestants, c’est dans la partie orientale de la chrétienté qu’elle va s’épanouir. Son origine se trouve dans la nuit des temps, à l’époque où les groupes d’humains habitaient et célébraient leur culte dans des grottes. Les peintures rupestres et pariétales font leur apparition avec les premières manifestations artistiques humaines lors de la Préhistoire, puis évolueront selon les lieux et la culture des populations concernées. Mais c’est au tout début de l’ère chrétienne que vont se fixer les règles de l’écriture des icônes. Entendons-nous dès le départ : l’icône est un art à part avec son propre langage. On ne peint pas une icône, on l’écrit. Il y a même toute une grammaire (langage des images) pour caractériser la symbolique de chacune des représentations. Ainsi, l’artiste qui crée des icônes n’est pas un peintre, mais un écrivain d’icônes.

Portrait de Fayoum. Portrait d’homme, « di Bello », Musée de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg Russie)
Au départ, même si elles sont une des caractéristiques des Églises d’Orient (tant orthodoxes que grégoriennes, nestoriennes, jacobites ou coptes), l’icône est présente dans toutes les communautés chrétiennes. Deux types d’icônes existent alors : l’icône pariétale (sur les murs des catacombes) et l’icône personnelle (miniature). Le premier écrivain d’icônes, selon la tradition orthodoxe, serait l’évangéliste Luc. Mais c’est dans les catacombes de Rome, dans les deux siècles suivants que va se développer cet art. Elles servent à garder en tête, dans la clandestinité, les principales caractéristiques de la religion nouvelle. On peint les murs avec des représentations des passages importants de la Bible (ce qui va donner en Occident le décor roman ; et en Orient les iconostases ou cloisons d’icônes). Assez rapidement, au IVe siècle, l’Église latine va poser un regard critique sur cette forme d’art alors qu’il va se développer dans le monde byzantin (ce qui sera plus tard l’Église orthodoxe).
Au VIe siècle, à l’image des portraits de Fayoum (sarcophages égyptiens : des portraits des défunts sont insérés dans les bandelettes de la momie au niveau de la figure du défunt), va se développer tout un langage religieux autour des icônes. La plus ancienne icône byzantine connue est celle du Christ pantocrator qui se trouve au monastère Sainte-Catherine-du-Sinaï et datant du VIe siècle. Elle a passé les épreuves du temps, résistant à la crise des iconoclastes (VIIIe au IXe siècle), à l’invasion musulmane, aux Croisades, etc. On y voit la première caractéristique, la représentation de face. Comme toutes les icônes byzantines, elle est écrite sur un support de bois et recouverte de fines couches de feuilles d’or ou d’argent, mais aussi de la peinture à l’encaustique (couleurs délayées à chaud dans la cire, puis étendues sur la surface choisie). C’est aussi à cette époque que s’écrivent les premières règles [de grammaire] de cet art : positions des cops et visages, proportions, couleurs, usages. Tout est fait selon des règles [ou grammaire].

Mosaïque de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours église Saint-Charles-Garnier
Au VIIIe et au IXe siècle, l’Empire romain d’Orient est pris dans le tourbillon de la crise iconoclaste. Partout dans l’Empire, mais principalement à Constantinople [maintenant Istanbul], les émissaires de l’Empereur et du patriarche vont détruire et bruler les icônes à cause d’une dévotion qui devient presque païenne. Quelques rares pièces résistent malgré tout à la destruction et l’écriture des icônes continue, clandestinement, dans les campagnes reculées de l’Empire. À la fin de cette période, l’écriture de l’icône aura trouvé ses standards et ses règles.
Inspirée de la dévotion antique des Grecs, se développe alors un art complexe de l’icône. Toute la théologie de la représentation se concentre dans la figure du personnage représenté : toute la spiritualité passe par la représentation du visage. Les yeux deviennent la représentation de l’âme par laquelle passent toutes les vertus ; la vivacité des personnages permet de mieux représenter leur caractère exemplaire ; le modelage reste naturaliste ; les figures sont à plat et les vêtements sont caractérisés par un drapé rigide et sévère.
Si on associe l’icône à Byzance, il faut aussi comprendre l’étendue de l’influence de Constantinople dans le monde de l’époque : une partie de l’Italie (Venise, Ravenne, la Sicile, les Pouilles) est encore liée à l’Empire romain d’Orient. C’est pour cette raison qu’on y trouve certaines icônes anciennes, mais aussi des appellations typiquement orientales. Par exemple, l’évêque de Venise est un patriarche, tout comme les évêques orientaux. Aussi l’importance du dôme remplace celle, tout occidentale, du clocher ou du campanile.
Malgré les guerres qui vont marquer la région, l’art de l’écriture de l’icône va se développer pendant les siècles suivants, toujours avec cette influence majeure des Byzantins. Lorsqu’arrive la crise du Grand Schisme d’Orient (1054), ou l’expansion de ce qui deviendra l’orthodoxie (la voie droite en opposition au catholicisme ou la voie universelle), l’art des icônes aura su se standardiser dans un langage (symbolique) fin, régi par une grammaire des plus complexes. Cet art sera tel que les écrivains d’icônes ne suffiront souvent pas à la demande : églises, monastères et chapelles vont s’affronter pour exposer le plus grand nombre, mais aussi les plus prestigieuses ; les individus voudront avoir dans leur maison de telles représentations des saints et du Christ ; les plus pieux et les plus riches voudront avoir avec eux de petites icônes miniatures qui les mettent en relation constante avec les saints.

Christ pantocrator (monastère Sainte-Catherine-du-Sinaï)
À l’époque des croisés, l’Occident redécouvre l’icône, supplantée sur son territoire par le décor peint des églises, chapelles, monastères et cathédrales. Des ateliers sont alors créés en Terre sainte, afin d’unir la vision romane de l’image à celle, byzantine de l’icône. Ces « nouvelles icônes » sont vendues aux croisés et à ceux qui s’installent en Terre sainte. Elles font le pont, de façon très temporaire, entre la chrétienté d’Orient et celle d’Occident. Après la période des Croisades, les ponts sont de nouveau rompus. Pendant la période du trecento (les années 1300, la première période de la Renaissance), l’art de l’icône continuera à trouver sa place dans l’Église catholique, alors que pendant ce même siècle, il se transforme en Orient. Mais à partir du Quattrocento, la rupture est de nouveau consommée. L’Occident catholique entre dans l’ère des grandes fresques et peintures, alors que l’Orient orthodoxe s’isole par l’importance de la présence des musulmans et Turcs sur son territoire.
À partir de la seconde moitié du XIVe siècle, la tradition de l’icône se déplace tranquillement vers la Russie en pleine expansion alors que l’étau turc se referme sur Constantinople. À partir de la prise de Constantinople par les Turcs (1453), l’écriture d’icône va évoluer de façon indépendante dans plusieurs régions : Russie, Empire ottoman, Balkans, etc. Avec les guerres d’indépendance, l’art de l’icône connaît une renaissance en Grèce et en Bulgarie, alors qu’en Russie, la production continue de prospérer.
Exposition :
Mireille Éthier. Exposition Parolicône, exposition des icônes de Gilberte Massicotte Éthier. Église de Saint-Michel de Sillery, 170, côte de Sillery

Exposition Parolicône (Église saint-Michel de Sillery) photo Métro – François Cattapan
Lieux :
Église orthodoxe grecque de l’Annonciation. 17, boulevard René-Lévesque Est Québec
Paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité de Québec. 945, avenue de Bienville Québec
Église copte orthodoxe de la Vierge Marie. 2160, rue Marie-Victorin Québec
Communauté orthodoxe Saint-Hilaire-de-Poitiers. 2960, boulevard Masson Québec
Église Saint-Charles-Garnier (mosaïque de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours). Boulevard Laurier, coin du Chanoine-Morel
Livres sur le sujet :
Alfredo Tradigo. Comment regarder les icônes et saints d’Orient. Paris, Hazan, 2020
Line Evequoz. Le carnet du peintre d’icônes. Lausanne, LEP, 2007 (enfants)
Moine Grégoire. Carnets d’un peintre d’icônes. Lausanne, L’Âge d’Homme, 2019
Romans
Catherine Hermary-Vieille. Les exilés de Byzance. Paris, Albin Michel, 2021
Metin Arditi. L’homme qui peignait des âmes. Paris, Grasset, 2021
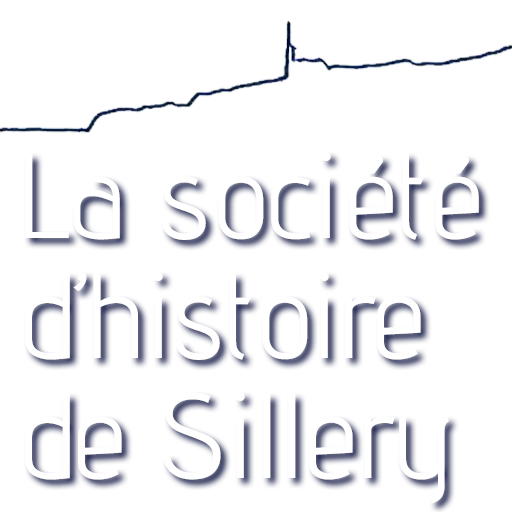
[…] clindamicina 300[…]
clindamicina 300