Élizabeth McKenzie
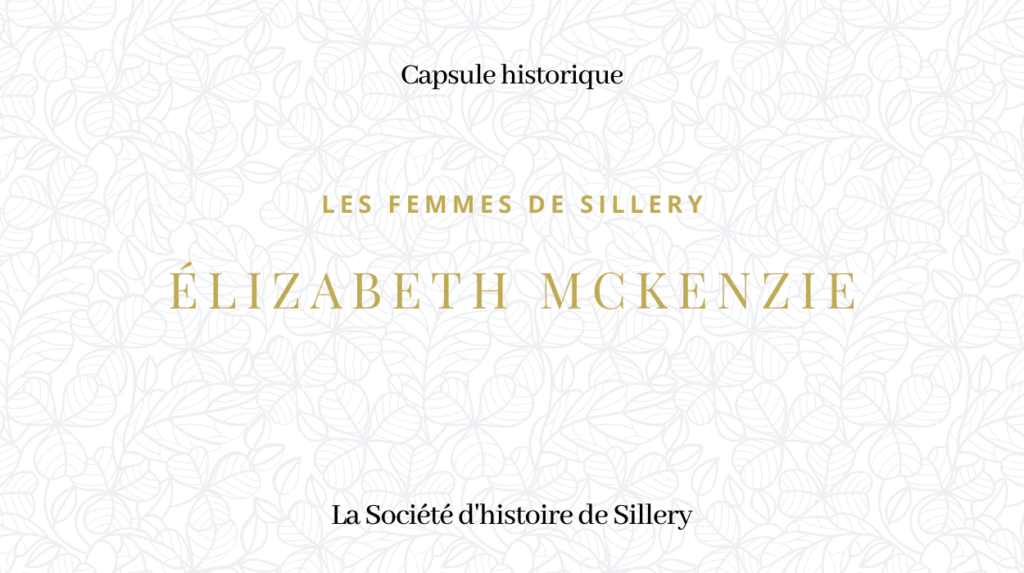
Votre capsule historique hebdomadaire : Élizabeth McKenzie !
Pendant plus de 100 ans, soit de 1840 à 1964, les femmes du Québec (et en grande partie de tout l’Occident) sont considérées comme une éternelle mineure. Alors que la Coutume de Paris garantissait à certaines femmes de la Nouvelle-France bien nées des capacités économiques, l’action concertée des conservateurs et des ultramontains du XIXe siècle vont enlever l’ensemble des droits économiques et politiques aux femmes. Surprenamment, certaines femmes vont réussir à se sortir de ce carcan. Les circonstances feront en sorte qu’elles pourront gérer leurs biens et en disposer comme bon leur semble. La Coutume de Paris est le code légal en vigueur en Nouvelle-France et pendant le Régime anglais, jusqu’en 1840. Ce cadre donnait deux droits à la femme : la dot et le douaire. La dot était un bien (monétaire ou autre) que la femme recevait en bien propre et qu’elle pouvait léguer. Le douaire était un bien (monétaire ou autre) que le mari laissait, à sa mort, en bien propre à son épouse. Avec l’Acte d’Union, les femmes canadiennes perdent ces droits.
 Lorsqu’Elizabeth McKenzie nait, en 1831, elle aurait pu bénéficier de ces droits qui ont encore cours au Bas-Canada. Elle est la fille de James McKenzie et d’Elizabeth Cameron. Son père est un humble Écossais arrivé comme soldat, mais qui rapidement fait fortune en devenant hôtelier puis constructeur de navires. Élevée dans la richesse, Elizabeth mène une vie aisée et pieuse, inspirée par les principes du presbytérianisme. Il n’est donc pas surprenant que la richesse familiale soit utilisée à des fins philanthropiques. Les œuvres philanthropiques envers le milieu anglophone presbytérien qu’elle a connues dans sa jeunesse vont se prolonger, de façon automatique dans sa vie d’adulte lorsqu’elle épouse, en 1867, le lieutenant-colonel James Ferdinand Turnbull. Par son mariage, elle unit deux fortunes : celle de sa famille dont elle sera une des héritières, et celle de son époux.
Lorsqu’Elizabeth McKenzie nait, en 1831, elle aurait pu bénéficier de ces droits qui ont encore cours au Bas-Canada. Elle est la fille de James McKenzie et d’Elizabeth Cameron. Son père est un humble Écossais arrivé comme soldat, mais qui rapidement fait fortune en devenant hôtelier puis constructeur de navires. Élevée dans la richesse, Elizabeth mène une vie aisée et pieuse, inspirée par les principes du presbytérianisme. Il n’est donc pas surprenant que la richesse familiale soit utilisée à des fins philanthropiques. Les œuvres philanthropiques envers le milieu anglophone presbytérien qu’elle a connues dans sa jeunesse vont se prolonger, de façon automatique dans sa vie d’adulte lorsqu’elle épouse, en 1867, le lieutenant-colonel James Ferdinand Turnbull. Par son mariage, elle unit deux fortunes : celle de sa famille dont elle sera une des héritières, et celle de son époux.
Pendant un peu moins que 40 ans, Elizabeth McKenzie va faire profiter la communauté écossaise de Québec de la fortune familiale. Figure dominante de la communauté écossaise presbytérienne de Québec, elle multiplie les dons aux organismes de bienfaisance : santé, éducation et groupes d’entraide sociale sont ceux qui profiteront le plus de ses largesses. Mais c’est l’hôpital de Jeffrey Hale qui bénéficiera le plus de ses œuvres de bienfaisance. Tout au long de sa vie, elle va financer cet hôpital qui se trouvait alors dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste.

Aile McKenzie de l’ancien hôpital Jeffrey Hale.,
La richesse propre d’Elizabeth McKenzie se comprend mieux lorsqu’on regarde son testament fait en 1903. N’oublions pas, à l’époque, et pour encore 60 ans, la femme est légalement considérée comme mineure et ne peut utiliser ses biens comme elle le veut. Elle dépend d’un homme, son époux lorsqu’elle est mariée, ses fils lorsqu’elle est veuve, ou son père ou ses frères lorsqu’elle est célibataire. Pourtant, la lecture de son testament est éloquente : elle lègue 10 000 $ au Ladies protestant Home (sur Grande-Allée, face à l’avenue Cartier), un autre 10 000 $ au Women’s Christian Association, l’ancêtre des YWCA. Un même montant est aussi cédé au Cimetière Mount Hermon afin d’assurer l’entretien perpétuel du lot familial et du monument funéraire de ses parents. L’église anglicane, dont est issu son époux, reçoit aussi une somme importante, soit 7 000 $ qui doivent être utilisés pour le soutien aux pauvres de la paroisse et pour « l’école du dimanche », l’apprentissage et la lecture de la Bible. L’église paroissiale de son enfance n’est pas en reste puisqu’elle lègue 5 000 $ à l’église St Andrew’s de Lévis afin d’en assurer le culte. D’autres institutions de Québec, de Charlevoix et de Toronto se distribueront 35 000 $. Ce sont principalement des églises, mais aussi l’ancêtre de la SPA qui bénéficieront de ses legs. Mais c’est l’Hôpital Jeffrey Hale qui aura la plus grande part de ses donations. En effet, en plus des multiples dons qu’elle lui a faits, elle remet, à sa mort, près de 100 000 $ qui serviront à l’érection d’un nouvel hôpital sur ce qu’on appelait alors le boulevard Saint-Cyrille. Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard qu’un troisième hôpital du même nom sera construit sur le chemin Sainte-Foy, tout à l’est de la ville de Québec de l’époque. Si elle lègue une telle somme, il y a quand même une obligation : que l’hôpital construise une aile portant son nom : l’aile McKenzie.

Photographie de Elizabeth McKenzie. Source : Diane Kameen, Société d’histoire de Sillery.
Pour confondre encore plus ses contemporains et les chercheurs, elle insère dans son testament une clause concernant son mari. Dans cette dernière clause, elle lègue à son mari tout ce qui lui reste de ses biens. À travers une fiducie gérée par le Royal Trust, elle lui laisse une rente annuelle de 5 300 $. Pour y arriver, elle fait faire des placements pour produire, à même le capital, des intérêts de 5 300 $. Pourquoi ce montant plus haut que la rente laissée à son mari ? Simplement que ses deux servantes reçoivent une rente annuelle de 150 $. Un an après l’enregistrement de son testament, soit le 31 mars 1904, Elizabeth McKenzie décédait à son domicile de la villa Clermont que le couple avait acheté aux héritiers de la famille Caron. Quant au lieutenant-colonel, il décédait le 3 juillet 1917.
Brève bibliographie
Marina Giroux et Frédéric Bonin. La villa Clermont, histoire d’un domaine patrimonial d’exception. Québec, Éditions histoire Québec, 2016.
André Miville. Profil socio-économique de propriétaires de villas de Québec au XIXe siècle. Québec.
